
The Black Keys - El Camino
Rarement, on peut maintenant le dire, un groupe aura attiré aussi rapidement les foudres de la presse musicale internationale. Pourtant les Black Keys, ce n'est plus tout récent. Depuis maintenant 10 ans les "clés du blues" continuent de faire frire leur blues cradingue aux quatres coins du monde, et ce même à Nantes il y a tout juste un an. Pourtant les Black Keys ont toujours découlé musicalement des White Stripes et non l'inverse. Pour le concept simple et radical : Un guitariste, un batteur. Pourtant les Keys ont certainement avec le temps su toujours se développer musicalement afin de ne pas s'enliser dans un style vu et revu. Une leçon que devraient tirer un jour Oasis.
Ainsi, les Keys à travers quelques albums ont su s'adapter merveilleusement à différents styles. A savoir respectivement, le Blues cradingue, le rock impulsif, la soul fiévreuse du samedi soir, ou encore...le hip hop New Yorkais avec leur superbe projet "Blakroc"! Définitivement le groupe n'a jamais vu l'avènement commercial. Même si certains titres comme 10 AM Automatic ou le frénétique Your Touch ont fini par percé la toile, le groupe été toujours devancé sur le plan international par les Whites Stripes qui pourtant partagent la même passion, mais pas de la même façon. Jusqu'à...jusqu'à...l'album Brothers sorti en 2010 où le groupe exploitait alors différents talents qu'ont ne leur connaissait pas. Par exemple celui d'injecté du Prince dans un air de blues véritablement dégueulasse. A savoir le résoluement fantastique Sinister Kid.

Vendu à plus d'un million d'exemplaires, Brothers plait, défonce le Top 50 en l'espace de quelques jours, les Black Keys se font alors connaitre par la grand public avec leur génial Tighten Up. Bientôt le monde connaitra l'avènement de ce qui reste aujourd'hui, l'un de meilleur groupe du rock contemporain. Sur El Camino, les Black Keys opèrent à deux changements : Fini les sous sols répugnants (où de nombreuses choses se passent) sans faux plafond pour un son plus crade (méthode inspiré du chef d'oeuvre des Sonics : Here are The Sonics) où le groupe s'était donné un malin plaisir à cradifier leurs sons pour un rendu unique. Et surtout, un chef opérateur derrière tout sa qui a su merveilleusement planifié la pépite du groupe, son nom : Brian Burton de Gnars Barkley. Qui les suis depuis Brothers mais a vu tout différent.
C'est simple, El Camino reste le tournant musical le plus jouissif depuis Radiohead et leur Kid A. Un tournant aussi intense n'a pu voir le jour sans réelles motivations, Dan Auerbach s'explique : "Chaque groupe doit évoluer, c'est quelque chose de radicalement important pour la vie du groupe, et le fait de composer avec Brian a tout simplifié." Les Keys que rien n'arrête sont alors partis, et plus rien ne les rattraperas. Après une soul diversifié sur le génial Brothers, El Camino se veux avant tout fleuri de nombreuses références à l'histoire du rock. Ainsi d'une part, Auerbach intensifie rapidement ses lignes vocales pour diversifier son jeu, à savoir le très pop "Sister". L'album se diversifie vers différent style, l'indé pour "Dead And Gone", le surf pour "Nova Baby". El Camino trace une ligne non directrice pour le plaisir auditif de chacun.

"On ne s'est jamais vu comme un groupe de blues" ajuste Auerbach. Effectivement, le son cradingue qui a donné tant de charmes aux compositions du duo est ici remplacé par un godmichet musical résolument moderne, et rock. A savoir pour exemple le génial "Lonely Boy" qui avec ses faux airs de groove sophistiqué, le groupe exploite toute l'étendue de son talent. La justesse remarquable de la voix, ou la réelle sincérité des textes d'Auerbach. Le matraqueur de cymbales Patrick Carney n'est quand à lui jamais loin, produisant son jeu tout aussi simple, puissant et accrocheur. Car ici, c'est définitivement la batterie qui suit la guitare. A la manière d'un Hendrix quelque part. C'est sur "Little Black Submarine" que les Keys rédigent leur mémoire rock en rendant hommage à Led Zeppelin. Seul véritable instant de l'album où Auerbach dévoile une aisance solo à la manière justement d'un certain...White.
C'est surtout le son d'El Camino qui rend cet album difficilement comparable avec les pépites précédentes. Radicalement rond, performant, le groupe intensifie alors l'utilisation de la basse ("Money Maker"), ou de l'orgue (le très boogie boogie "Gold On The Ceiling") fraichement sorti de Kraftwerk. Fantastique. Pour la plupart, on aura tendance à dire que les Keys puisent dans le rock radicalement contemporain tout en y injectant le blues et le groove nécessaire pour affirmer leur dépendance au rock "qui a disparu au courant des années 70". Un groupe épargné de toute dictature financière, se permettant de jouer avec les très ironiques "Money Maker" ou "Mind Eraser". Définitivement, les Black Keys ont su concentré la plupart de ceux qui ont marqué leur vie en seulement 11 chansons. Car eux, ne voudront certainement jamais de l'enlisement produit par un hypothétique double album.
El Camino magnifie à jamais les Keys, qui grâce à leur coup de Poker (On change les codes mais le style) se font à la fois connaitre par le grand public et adoubé par la critique (même par les snoby snobs intellos, forcément). On le sait donc, les Black Keys sont géniaux et ce n'est que le début. Gold On The Ceiling...


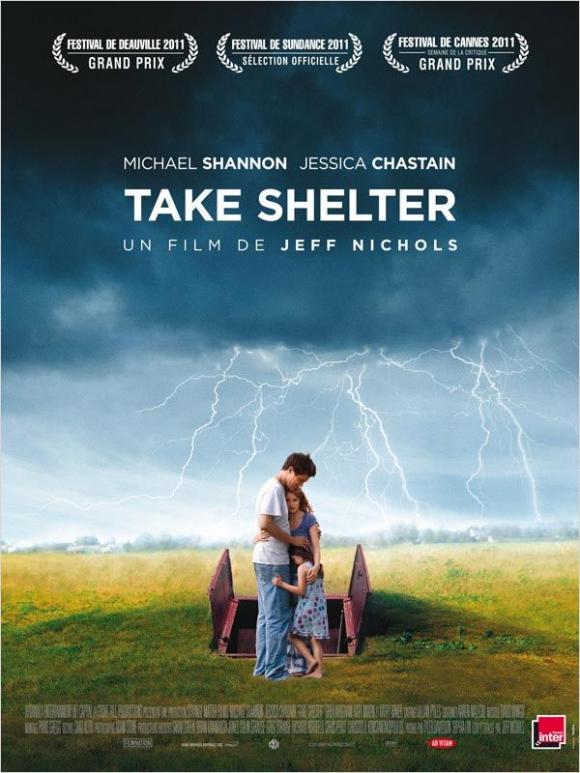







.jpg)






