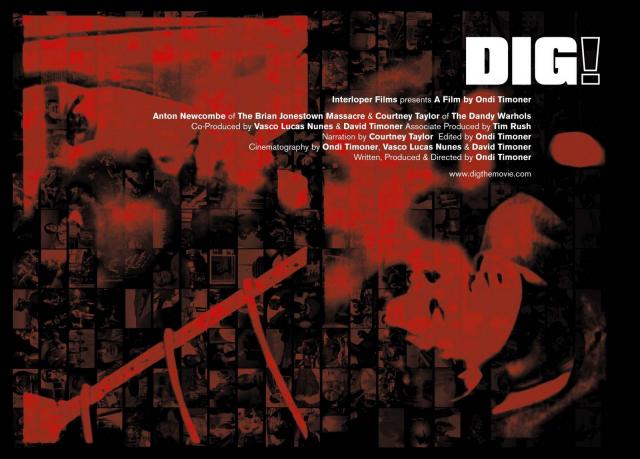John Dies At The End de Don Coscarelli
On cherche tous à posséder une bonne excuse pour prendre de la drogue. Qu'elle forme soit-elle, l'amour, la musique, les produits. Surtout les produits. Très généralement orchestrés de dynamite par le commun des mortels, elle sert d'inspiration à de nombreux musiciens maintenant pour la plupart perchés non loin de St-Pierre, ou sur un bout de lune. David Wong admet quand à lui que celle-ci permettrait de sauver le monde. Non pas que la prise de substance illicite soit remarquable pour sauver les peuples les plus démunis ou contrer la crise et emmerder les banquiers de la planète. Non. Selon David Wong, la drogue ouvre des portes vers l'inconscience la plus extrême possible. Loin de tout aspect physique, mais au gré des dimensions parallèles non visible par ce même commun des mortels.
En gros, nous sommes attaqués par des monstres, prenez de la drogue pour les voir.
C'est sous cette dynamique que né en 2007 le roman John Dies at The End. Publié sous forme de feuilletons de l'arrache sur un site internet, la mini-série prend alors les chemins de l'édition sous l'été 2008. A ce même moment, Don Coscarelli, cinéaste sous-estimé et indépendant (comprenez, « ne pas me faire chier, je fais ce que je veux. #jepisseàlaraiedhollywood ») se voit télécharger le bouquin au hasard sur Amazon. Jackpot pour 10$, Coscarelli achète les droits dans la même soirée où il finit le livre. Son auteur : David Wong. Subtile mise en abîme du personnage principal du livre se cachant son nom sous celui du caractère. Sacré Dave.

John Dies At The End est un livre à part. Ce qui invoque un film ailleurs. Éloigné de toutes linéarités communes et radicalement fiévreuses, son aventure semi comique/horrifique prend les traits de David Wong. Un type à la ramasse qui ne comprend pas ce qui se passe au jour le jour. Le malheureux et son meilleur ami John (un type de loin plus perché que David) sont alors confrontés (non pas de force mais de gré pour l'un d'eux) à la Joy Sauce. Source de délire optique et visuel, et de contemplation de grillages ferroviaires. Soit la drogue la plus puissante jamais réalisée, ouvrant des tunnels vers l’exploitation de dimensions parallèles dont les deux geeks sont alors immortalisés comme étant les sauveurs de ces mondes perchés à l'instar de leurs aînés. Sans le savoir, et sans le vouloir, voilà les nouveaux Bruce Willis du pauvre sauveurs du monde.
Quoi de plus simple après un coup de seringue ?
Dans cette optique, Don Coscarelli y voit un film dont il serait presque impossible de parler tant le sujet est disloqué, et que la narration du roman est oblique. Réalisateur du chef d'oeuvre le plus certainement ignoré de ces 15 dernières années - magnifique Bubba HoTep – Don Coscarelli réalise un film entre Une Nuit en Enfer et Human Traffic. Prônant le fantastique à l'absurde, le comique à l'horreur sanguinolente. Véritable jouissance artistique pendant 1h30, John Dies At The End (mis à part spoilé la fin dès le titre) part en vrille continuellement. Et c'est une réussite totale, dont peu auraient parié sur la nature finale du produit.
Explications droguées...détaillées.

Tout d'abord l'exploitation de l'inconscience dont fait preuve Coscarelli, honorant jusqu'au dernier détails les volontés de Wong (poignet de porte en forme de sexe, ou la chute finale absurde et hallucinante). La mise en scène de Coscarelli, détaillée et s'adaptant aux prises de drogue, est sans doute l'un des excellents points de John Dies At The End. Ne prenant jamais de parti sur les effets de la drogue (en aval) Coscarelli se contrefout de cette démagogie embarrassante pour ainsi n'extirper que de dialogues complètement décalés et surprenants au possible. Shooté à la steady-cam la plupart du temps, le spectateur est alors immédiatement transporté (au sens propre et figuré) dans ce western horrifique jamais très éloigné de Fantômes contre Fantômes (en mieux, désolé Peter...)
Endossé par deux brillants acteurs que malheureusement nous ne serons pas prêt de revoir, John Dies At The End assume tous ses côtés cheaps et low : monstre fait de saucisses en animatronique, nihilisme profond du sujet, dialogue absurdes et relativement cons mais profonds, effets spéciaux méga cheaps et beauf..Le retour en grâce de Don Coscarelli fait plaisir, et promet une suite de Bubba Ho-Tep méchamment bandante à la jouissance des premières fois. Car John Dies at The End ne s'arrête pas au simple fait qu'il soit nihiliste de bout en bout. Le film peut s'apparenter à une énorme prise de confiance de deux attardés de la vie cachant un mal-être. Coscarelli prend le bon choix de ne pas s'attarder tant de temps sur ce sujet pour se déchaîner dans une déferlante d'idées toutes les plus abusives qu'inventives.
De quoi plaire à un lecteur de Mad Movies, de quoi emmerder un lecteur des Cahiers du c[hi]énima, telle est la vie, tel est le cinéma. Et lorsque le cinéma prend cette forme, c'est dans mon pontalon (et peut-être le vôtre) que l'apocalypse se joue et se dénoue...Hum.