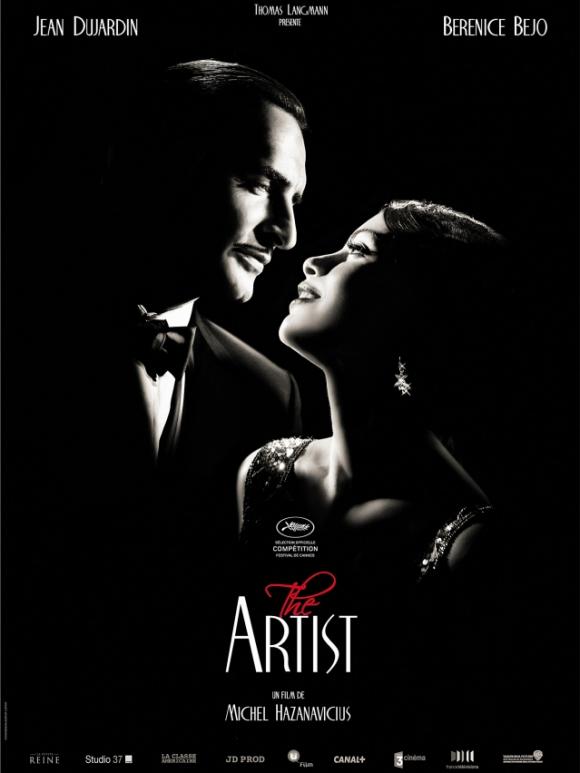Moonrise Kingdom de Wes Anderson
Eeeeeeeeeeeeet c'est parti! 12 jours de coke, luxure et compagnie pour Cannes 2012 ! Alors bon, on aurait tord d'en mettre plein la gueule au Festival (avec un grand F) du 7ème art. Celui qui cette année rend tout même hommage à la fille qui a besoin de mots doux (Poupoupidou ?). Surtout que Nichols, Salles, Dominik, Cronenberg, Hillcoat ou Loach présentent leurs nouveaux films (rien que sa ?). On ira donc pas piétiner sur ce menu hyper croustillant que le festival nous promet cette année. Menu qui nous servait en amuse gueule Moonrise Kingdom, nouveau film de l'enfant de toujours Wes Anderson. Une vieille branche pommé entre ses délires frapadingues de Dora l'exploratrice (Fantastic Mr. Fox) ou ses grands trips océaniques (La Vie Aquatique). En somme un réel personnage bien foutraque.
D'autant plus que Moonrise Kingdom raconte l'histoire (que l'on pense à coups sûrs autobiographique, ou presque) d'un jeune couple de 13 ans qui se met en tête de vivre une sorte de Ballade Sauvage à la Malick. Sans les meurtres. Hippies au 78ème degrés, Sixties au premier. C'est dans une optique enthousiaste que Wes Anderson décide de propulser son film : immerger un univers de gamin, dans un corps de grand. Immergeant de plein fouet le spectateur dans ce monde potache, aux couleurs vives, aux idées farfelues. Sans réel équivalent cinématographique le film d'Anderson se lance à corps perdu dans cet élan de gentillesse presque puérile. Le monde des télétubies revu et corrigé (et "bim" Popo!)

Moonrise Kingdom est une hymne à la joie, sans réelle crédibilité, mais d'une sincérité absolue. Pendant une heure trente, trois générations sont exploitées au grand gré d'une d'entre elle (les vieux forcément!). Wes Anderson dresse le portrait d'une Amérique rase motte et lui rend hommage de la plus belle des manières. Tout d'abord sur le plan cinématographique : l'ambiance kitsch est présente des les premières bobines (la police du générique très cul cul la praline) mais c'est surtout dans sa mise en scène qu'Anderson rend quelque part hommage à un mix improbable entre un Dutronc et un spot pour parfum Français des années 60.
En effet, Anderson se limite au strict minimum pour une animation très picturale : Peu de raccords, sens inné du travelling latéral...Faisant alors germé l'idée que son film n'est autre qu'une immense pièce de théâtre psychédélique. Les gros plans sont rares, preuve (ou pas?) de l'importance que dresse Anderson de l'image de ses deux tourtereaux dont le discours libérateur/de petits chieurs nous emballe par autant sa vivacité que par sa naiveté. Servi sur un plateau d'or par de formidables comédiens (les deux petites marmottes donc, Willis, Tilda Swinton) c'est surtout le génial -charismatique - frapadingue - sous côté - immortel Edward Norton qui emporte la palme du coeur dans un rôle des plus foutraque de sa carrière. Une perle.

Et puis, l'air de rien, le film s'envole vers des thématiques chères au cinéma des enfants, la fugue certes pour échapper au monde adulte dont ils craignent la bestialité ou la morosité (au choix), le mariage utopique, l'amour des 13 ans, le sexe aussi. Car celui ci, est relativement sous-jacent pendant tout le film. Comme la plupart des thèmes, la découverte de la sexualité est ici passée à la moulinette du troisième degré quitte à être politiquement incorrect pour le plus grand bonheur du spectateur.
Grand moment d'émotion, Moonrise Kingdom semble appartenir à un certain genre de film intouchable. Trop gentil et vierge dans l'esprit pour déployer les armes de l'objectivité face à cet élan de bluette sentimentale. Porté par une main de maitre dans un cinéma de topographe (la symétrie bestiale des plans est effarante et ajoute à ce film son côté cul cul la praline), Moonrise Kingdom a ouvert de la meilleure façon ce festival devenu la place proéminente des stars du 7ème art en manque d'affections de la planète. Le film d'Anderson est à l'image du personnage incarné par Ed Norton, incorrigible et tolérable. C'est le temps de l'amour.