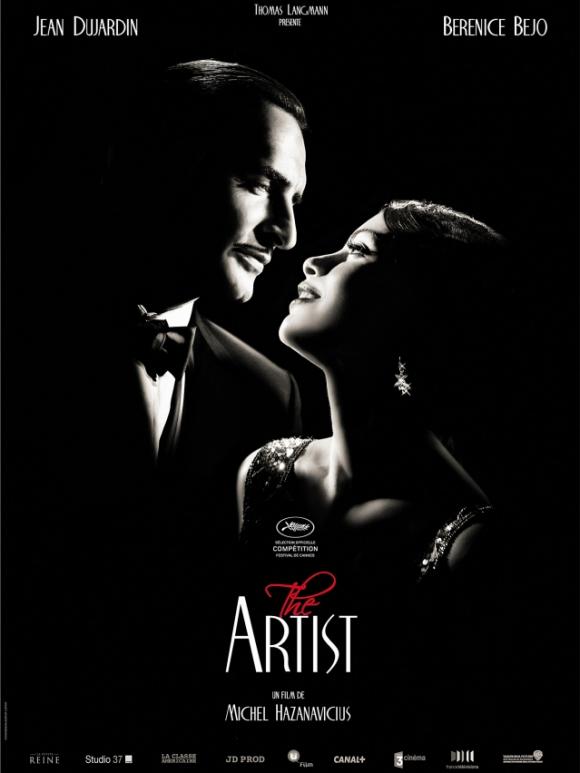Bellflower d'Evan Glodell
Avec tout le respect que l'on doit aux réalisations amateurs ( je ne parle pas du found footage ou autre descendant lambda du débilos Paranormal Activity ), il faut parfois faire attention. A ce que ceci ne soit pas qu'un argument de vente pour la presse branchée couilles cousues à aller voir des oeuvres aussi expérimentales que foutraques. C'est ce à quoi l'on pense lorsque l'on peux voir ne serait-ce que deux péloches de la bande annonce de BellFlower, réalisé par un certain Evan Glodell durant l'été 2008 pour la maudite somme de 17.000 dollars ! Se voulant amateurs jusqu'au bout, le réalisateur en herbe en aurait même profité pour construire l'ensemble du matériel que l'on peux voir à l'écran ( voiture, lance flammes, motos...même caméras! ) Un vrai psychopathe en somme entre Jackson et Tarantino pour le besoin maternel de monter un film.
Excavé du plus profond de la mine d'or du cinéma indépendant Américain, Bellflower se fait enfin connaitre en cette année 2012, dernière année de l'être humain ? Parfait pour le pitch dans lequel Glodell semble avoir enraciné tous ses souvenirs ( branleurs Américains perdus, mi hapsters ) et sa mélancolie puisque Bellflower traite du sujet de l'amour...pré-apocalyptique. Explications : Deux types totalement ravagés par l'alcool et le manque de repères, se mettent en tête de régner sur le monde une fois l'apocalypse arrivée. A la manière d'un Mad Max et de son ennemi de toujours : Le Seigneur Hummungus. Sauf qu'il n'était pas prévu que l'un tombe amoureux, et que l'apocalypse n'aura pas forcément lieu là où l'on l'attend.

Et c'est justement dans cette idée, relativement proche du film de genre que Bellflower expose toutes ses idées : La mélancolie, la fin de l'adolescence, le refus des responsabilités. A la manière d'un Madmax qui lui exploitait la fin des espérances, Bellflower se veux beaucoup plus enthousiaste avant de sombrer dans une seconde partie où la folie finira par régner. Les personnages présents à l'écran sont tous alors brutalement secoués dans le monde adulte, chose qu'ils ne souhaitent pas. Comme si Fight Club et sa critique assassine de la société avait rencontré le Drive de Refn. Ce qui aurait pu passer pour une parabole artificielle sur le début des responsabilités est au final beaucoup plus subtil que ce à quoi l'on pourrait s'attendre.
Scindant son film en deux parties, Glodell réussit dans un premier temps à imprégner son roman d'une mélancolie relativement personnelle -lui même avouant s'être inspiré de...lui- adoucie par la formidable bande sonore de l'inconnu Jonathan Keevil qui dans toute la splendeur du film indépendant Américain, chante guitare à la main d'une voix décousue, voilée. Magnifique. Dans cette même partie que la mise en scène de Glodell prend du relief. L' Amérique telle que l'on la connait (bonasses aux quatre coins de rue, plastique de rêve, surfeurs ou Macdo ) prend soudainement fin. A l'instar d'un Jeff Nichols dans la magnifique Shootgun Stories sans le côté Malick; une partie de l'Amérique rase motte est dévoilée : Un no man's land ravagé, pleins de soulards sans jobs, et sans aucune conscience. Une génération perdue, qui à force de s'être pris des vagues dans la gueule, s'en remet à la shouille.

C'est ici que Bellflower touche son but, en sublimant de toutes sortes l'aspect plastique du film -qu'on le veuille ou non !- en réussissant la renaissance de ses caméras foutraques (sables dans la lentille, fibre optique trop courte...). Une mise en scène originale et qui à la manière d'un Refn aurait essayer de se focaliser sur l'esthétisante musique électro-pop pour donner vie à ses séquences parfois bluffante. Submergé par la photographie épileptique du film ( sa rappelle sans aucun doute les Rois du Désert! ) donnant la sensation de chaleur omniprésente, Glodell dans une seconde partie presque parfaitement maitrisé (à deux cheveux près) montre sa vision de l'apocalypse. Comme le désarroi d'un adolescent près à casser la baraque à la suite d'une rupture. Cette apocalypse aura donc lieu dans la tête du protagoniste, l'autre ne verra jamais le jour.
Enfin, formidablement Glodell -à l'instar de Madmax 2 : The Fury Road- réussi à donner toute puissance à son interceptor, car le personnage central du film n'est autre que la Medusa. Semblable au V8 de Max Rocktansky, elle est le symbole de toute la démesure juvénile du protagoniste qui finira par se servir de ses propres inventions pour mettre fin à tous ceux qui l'ont fait souffrir dans une fin proche du slasher horrifique. Dans une magnifique conclusion, juxtaposant deux fins alternatives, Glodell se permet l'impensable : Avec une comparaison directe au chef d'oeuvre de Miller, une esthétique très publicitaire et une contre plongée dans le désert, de poser un discours nihiliste quoi que trop existentialiste sur la vie du personnage principal. Et même si l'on a tendance à penser que ce nihilisme à la Gavras nous aurait plu tout au long du film.

Face à tant d'idées, il est impensables de ne pas ressortir troublée par ce que l'on vient de voir. Un film fou, très exactement. Loin des conventions du genre, mais sans jamais s'éloigner pour garder une approche simple, Bellflower semble avoir tous les atouts du premier film : Une sincérité profonde, un "je m'en foutiste" totalement assumé, et un condensé de clin d'oeils. Le genre de film qui ferait passé une amourette de passage pour la femme de notre vie. Fou, on vous l'avait dit.